
Dans ce module, nous allons explorer le monde des identités de genre, qui est très complexe et multiforme, et dans lequel chacun-e d’entre nous peut trouver sa place. Tu trouveras de nombreux mots dont tu n’as peut-être jamais entendu parler, et cette liste pourrait même continuer à s’allonger à l’avenir, afin d’englober l’incroyable diversité que nous représentons tous-tes.
C’est parti !
Voices - Module 2
Introduction
L’Organisation mondiale de la santé définit le genre comme “les caractéristiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons qui sont socialement construites. Cela inclut les normes, les comportements et les rôles associés au fait d’être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre elleux. En tant que construction sociale, le genre varie d’une société à l’autre et peut évoluer dans le temps”.
Comme le montre cette définition, notre société est fortement binaire, ce qui signifie que le genre binaire entre les hommes et les femmes est considéré comme la norme et le standard. Dans ce module, nous verrons que la réalité est en fait plus complexe que cela ! De nombreuses personnes n’entrent dans aucune de ces catégories et le genre est beaucoup plus fluide qu’il n’y paraît. Il est important de comprendre que, dans ce module, nous considérons le genre comme non binaire et donc, comme un spectre. Le spectre du genre, par opposition au binarisme de genre, est un modèle que nous utilisons pour comprendre le genre comme une notion qui existe dans un continuum dans lequel les frontières entre le masculin et le féminin sont plus nuancées. Ce modèle permet aux personnes de mieux s’identifier et se reconnaître dans leur identité de genre.
Le genre a un impact considérable sur la vie quotidienne des gens parce qu’il régit les normes, les rôles et les stéréotypes liés au genre (une idée largement répandue mais figée et simplifiée à l’extrême d’un type particulier de personne ou de chose), influençant la manière dont les gens sont censé-e-s se comporter et créant une hiérarchie dans laquelle certains genres ont plus de privilèges que d’autres. Du fait que nous vivons dans une société patriarcale (nous verrons plus tard ce que c’est), nous sommes confronté-e-s à des idées très strictes sur la masculinité et la féminité, ce qui signifie que nous apprenons dès notre plus jeune âge ce que signifie être un homme ou une femme. Ces idées ne sont pas intrinsèquement mauvaises ou erronées, elles peuvent trouver un écho en nous et nous permettre d’être nous-mêmes ; mais lorsque ces idées deviennent des stéréotypes discriminatoires, elles se transforment en outil d’oppression à la fois pour les personnes qui se reconnaissent dans le schéma binaire du genre et, surtout, pour celles qui ne s’y reconnaissent pas. Elles peuvent donc devenir un obstacle sur notre chemin personnel. Qu’il s’agisse de filles pratiquant des sports “masculins” ou de garçons apprenant à s’occuper de la maison, les stéréotypes de genre peuvent laisser peu de place à notre épanouissement personnel et à notre satisfaction.
Dans ce module, nous essaierons de déconstruire la binarité du genre, en montrant la complexité du spectre du genre, pour avancer sur l’égalité de genre.
Vocabulaire clé et définitions

Le spectre de genre
Définition nuancée du genre au-delà, entre et en dehors de la binarité homme-femme

Sexe assigné à la naissance
L’état (masculin, féminin, intersexe) attribué à la naissance. Il comprend le sexe génétique, le sexe gonadique et le sexe hormonal.

Identité de genre
Sentiment intérieur d’appartenance à un genre.

Orientation sexuelle et romantique
L’orientation sexuelle ou romantique définit les personnes qui t’attirent sexuellement ou romantiquement. Contrairement à l’identité de genre, qui définit ce que tu es, l’orientation sexuelle ou romantique concerne les personnes vers lesquelles tu te sens physiquement et romantiquement attiré-e.

Expression de genre
La manière dont une personne exprime son identité de genre, généralement par son apparence, sa tenue vestimentaire et son comportement.

Identité sexuelle
La somme de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de l’orientation romantique, de l’expression de genre et des rôles de genre.
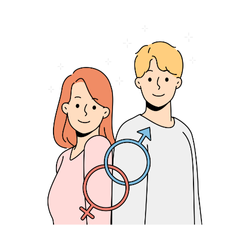
Cisgenre
Une personne dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance

Transgenre
Une personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance.

Trans*
Terme générique pour reconnaître toute personne dont l’identité de genre est différente de la cis-normativité en soi considérer l’identité cisgenre comme la norme.

LGBTQIA+
Acronyme : Lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, trans*, queers et en questionnement, intersexué-e-s, asexuel-le-s et aromantiques, plus (+) d’autres étiquettes définissant la communauté queer.

Prénoms choisis / Pronoms choisis
Prénom et pronom(s) choisis par une personne trans* pour s’adresser correctement à elle

Stéréotypes de genre
Opinion trop simpliste de ce que devrait être une personne en fonction de son identité de genre

Non-conformité au genre
Inadéquation avec les rôles genrés traditionnels attendus par la société
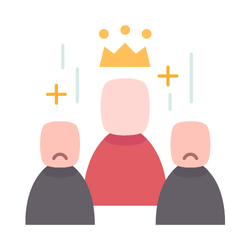
Privilège
Accès non mérité ou avantages accordés à des groupes spécifiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe social. Les privilèges peuvent être basés sur une variété d’identités sociales telles que la race, le genre, la religion, le statut socio-économique, les capacités, la sexualité, l’âge, le niveau d’éducation et bien d’autres encore.
Les privilèges peuvent être ressentis au niveau personnel, interpersonnel et institutionnel. Les avantages sociaux, économiques, politiques et psychologiques non mérités que détiennent les groupes privilégiés se font au détriment des groupes marginalisés. – 2021 Défi pour l’équité jour 3 : qu’est-ce que le privilège ?
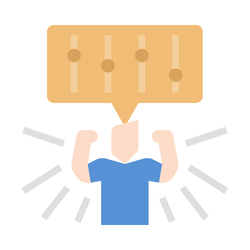
Patriarcat
Le patriarcat se réfère à la fois au pouvoir global plus important que les hommes ont sur les femmes et les autres genres – social, politique, économique – ainsi qu’aux hiérarchies de pouvoir entre les hommes individuels et les groupes d’hommes, y compris les hommes transgenres. – Patriarcat (n.d)
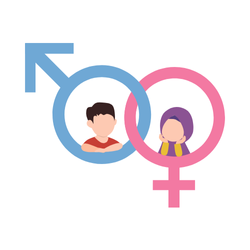
Binarité de genre
Système de classification des genres dans lequel toutes les personnes sont classées comme étant : masculin ou féminin. – Dictionnaire Oxford

Égalité entre les hommes et les femmes
L’idée que les femmes et les hommes, les filles et les garçons et les autres genres bénéficient de conditions, d’un traitement et de chances égaux pour réaliser pleinement leur potentiel, leurs droits humains et leur dignité, et pour contribuer au développement économique, social, culturel et politique (et en bénéficier) – Kassel G. 2023

Homolesbobitransphobie
Ce terme regroupe l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, et donc la haine, la peur, le malaise et la méfiance à l’égard des personnes ayant ces identités de genre ou orientations sexuelles.
Rôles et stéréotypes de genre : Le genre comme binarité
Qu’est-ce que les rôles et les stéréotypes de genre ?
« Je pense avoir ressenti le poids de certains stéréotypes sur ma peau, même de manière très subtile, de sorte qu’il est difficile de les identifier comme des plaisanteries ou des commentaires. Une chose qui me vient à l’esprit est que le premier sport que j’ai commencé dans mon enfance était la danse, puis j’ai voulu commencer le football, mais je n’ai pas été autorisée à le faire pour des raisons diverses et confuses. En me découvrant de plus en plus au fil du temps, je me suis rendu compte que, parfois, j’étais mieux habillée avec des vêtements ou des accessoires qui sont généralement plus masculins ».
Par rôles de genre, nous entendons qu’il y a des “choses considérées comme étant pour les filles” et des “choses pour les garçons”, comme certains jeux, vêtements, endroits à fréquenter qui sont plus appropriés pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes. Les idées de masculinité et de féminité, ainsi que de ce qu’est un homme et de ce qu’est une femme, peuvent changer en fonction de l’endroit où tu vis et de la façon dont la société qui t’entoure est construite. Ces idées peuvent ou non correspondre car, comme nous l’avons dit, le genre est plus un spectre qu’un système binaire, et tu peux te reconnaître dans un mélange de ces deux types d’idées ou dans aucune. Néanmoins, il est important de comprendre que ces constructions affectent la manière dont nous avons été éduqué-e-s depuis le début de notre vie, dans la façon dont nous exprimons nos émotions, les jouets que nous devrions utiliser lorsque nous sommes enfants, les vêtements que nous devrions porter, etc.
« Lors d’un repas de famille, quelqu’un a fait une remarque sur ma mère et j’ai perdu mon sang froid et manqué à mon devoir de gentille fille, souriante et bien élevée. À ce moment-là, je me suis dit : « Pourquoi je devrais être comme ça, polie, gentille, etc… ? » Je veux du chaos, de la colère, et moi aussi j’ai le droit de m’exprimer ! »
Par exemple, il est courant de s’attendre à ce que les personnes socialisées en tant que femmes aient un désir de famille et de maternité, qu’elles soient féminines, gentilles et émotives, tandis que les hommes aient des ambitions et une carrière, qu’ils soient masculins, forts et courageux. Mais faisons une distinction :
- La masculinité et la féminité sont des concepts qui déterminent qui tu dois être et ce que l’on attend de toi en tant qu’homme ou femme. Par exemple, les personnes socialisées en tant que hommes doivent avoir des ambitions professionnelles, être sûrs d’eux, “rationnels” et fermes, avoir une attitude de “patron” ; les personnes socialisées en tant que femmes doivent se préoccuper de leur espace domestique, désirer avoir des enfants, ne pas avoir d’autres ambitions spécifiques et être “émotives”.
- La masculinité et la féminité sont des caractéristiques d’apparence et d’attitude conçues pour les deux genres. Par exemple, si tu es audacieux-se, que tu choisis des tenues sportives ou que tu aimes regarder ou pratiquer des sports de toutes sortes, ou si tu ne te soucies pas des normes cosmétiques et esthétiques pour ton corps (c’est-à-dire tout ce qui a trait à l’apparence, de l’utilisation de parfums à la prise de rendez-tu chez le coiffeur), tu seras considéré-e comme “masculine” ou “virile”. Au contraire, si tu aimes les couleurs délicates, les robes bouffantes et/ou le maquillage et les produits cosmétiques et esthétiques, tu seras considéré-e comme “féminine”.
« Dans ma famille, on attendait de moi que je sois à la cuisine et que je m’occupe des tâches ménagères, ce qui n’était pas le cas de mes frères ».
Les rôles de genre sont des stéréotypes parce qu’ils ne sont pas fondés sur des différences naturelles et héréditaires, mais sur des idées généralisées et simplifiées à l’extrême d’un certain genre qui sont construites par la société. Comme tous les stéréotypes, ceux liés au genre s’accompagnent d’attentes genrées strictes qu’il est difficile de démanteler. Les attentes liées au genre définissent ce que nous apprenons à attendre d’un-e individu-e appartenant à un certain genre : comment agir, se comporter et paraître. Il ne s’agit pas seulement d’une attente personnelle que nous projetons sur les autres en les regardant passer : il s’agit d’une éducation sociétale et culturelle dans laquelle nous grandissons en raison des normativités sociétales. Cette éducation nous pousse à adopter une certaine façon d’être très stricte. Consulte le module 5 pour en savoir plus sur ce que nous entendons par normativités et stéréotypes.
Les rôles des hommes et des femmes sont déterminés par la culture ! La notion de genre peut être très différente d’un pays à l’autre, et même dans un même pays ou une même ville, on peut trouver des différences. Cela s’explique également par le fait que le genre est une construction sociale et culturelle.
« Quand j’avais 5 ans et que je voulais jouer au foot avec mon frère et ses amis, ils m’ont tous dit en même temps que je ne pouvais pas parce que j’étais une fille, que je devais aller avec mes cousines et jouer avec les Barbies ».
Bien sûr, on peut se retrouver à correspondre à une grande partie des rôles de genre, mais on peut aussi s’identifier comme une femme et aimer le sport, s’habiller “comme un garçon” et être une joueuse phénoménale ; de même, on peut s’identifier comme un homme et être un grand maquilleur. Ce que nous allons voir, c’est que le schéma binaire des genres n’est qu’une des nombreuses possibilités d’être.
« Le stéréotype selon lequel les femmes sont plus dociles m’a souvent mise mal à l’aise, car c’est ce que l’on attend de moi et ce n’est pas vrai ».
Le patriarcat est à l’origine des rôles et des stéréotypes liés au genre. Le patriarcat est un système social d’oppression qui privilégie un genre par rapport aux autres. L’étymologie (du grec patriarkhēs, qui signifie “père dirigeant”) nous révèle que le genre hégémonique (dirigeant, dominant) est celui des hommes, en particulier des hommes hétérosexuels, cisgenres, valides et blancs. En créant une hiérarchie entre les genres, elle place certains genres dans une situation d’oppression plus grande que d’autres. Ainsi, par exemple, un homme cis-hétérosexuel a plus de privilèges qu’une femme cis-hétérosexuelle qui est plus privilégiée qu’une femme cis-lesbienne, qui est plus privilégiée qu’une femme trans, et ainsi de suite. Bien entendu, cette pyramide est une simplification. Nos identités sont bien plus complexes que cela, tout comme nos relations. Mais elle nous aide à nous rappeler que nous faisons partie de ce système. Nous agissons, réagissons et sommes tous-tes opprimé-e-s par le patriarcat de différentes manières et il est important de ne pas aplanir ces différences.
Il est également important de se rappeler que le système patriarcal opprime tous les genres parce qu’il tente de les confiner dans les normes sociales, les rôles et les stéréotypes que nous avons mentionnés précédemment. Ainsi, bien que le patriarcat profite aux hommes, parce qu’il les place dans des positions de pouvoir, le coût de ce privilège est élevé. Les idées de virilité et de masculinité agissent souvent comme une cage en raison des limites considérables qu’elles imposent à ce qu’un homme devrait être et à la manière dont il devrait agir. Les attentes liées au genre sont si exigeantes qu’il est impossible de toutes les satisfaire : les boîtes dans lesquelles nous devons entrer pour répondre aux prérogatives patriarcales sont trop petites pour toutes les possibilités d’être, quelle que soit votre identité de genre.
Les 4 dimensions du genre – Le genre en tant que spectre
Pour mieux comprendre ce que nous entendons par “spectre” du genre, nous pouvons le considérer comme composé de quatre dimensions, qui créent, non pas une ligne droite avec seulement deux extrémités, mais une immense carte avec différentes directions.
Ces dimensions sont : l’identité de genre, l’orientation sexuelle et romantique, l’expression de genre et le sexe assigné à la naissance.
Sexe assigné à la naissance
Le sexe est attribué à la naissance, en fonction de l’apparence du corps. Par définition, il comprend le sexe génétique (chromosomes), le sexe gonadique (organes génitaux et caractères sexuels secondaires) et le sexe hormonal (hormones comme les œstrogènes et la testostérone) : à votre naissance, les médecins ont déterminé, en fonction de tous les facteurs susmentionnés, si tu es un-e individu-e mâle, femelle ou intersexe.En général, les femelles ont des chromosomes XX et les mâles ont des chromosomes XY.
Intersexuation est un terme général utilisé pour désigner diverses situations dans lesquelles une personne présente, à la naissance ou plus tard, par exemple à la puberté, une anatomie reproductive et/ou sexuelle qui ne correspond pas aux catégories socialement construites de “femme” ou d'”homme”.
Il existe différentes conditions d’intersexuation, allant des conditions hormonales (moins visibles) aux conditions génitales (plus visibles), qui diffèrent du modèle binaire tel que nous l’avons conceptualisé. (voir module 4)
Identité de genre
L’identité de genre est un sentiment intérieur d’appartenance à un genre. En règle générale, le genre est également assigné à la naissance en fonction du corps et des facteurs susmentionnés. Mais aujourd’hui, nous savons que le sujet est plus complexe que cela, car il peut correspondre au sexe assigné à la naissance en fonction du corps et des organes génitaux, mais il peut aussi être différent.
Lorsque ton identité de genre correspond au genre associé au sexe qui t’a été assigné à la naissance, tu es cisgenre (du latin cis- “de ce côté-ci”) ; si ton identité de genre ne correspond pas au genre associé au sexe qui tu a été assigné à la naissance, tu es transgenre (du latin trans-, “à travers, au-delà, sur, de l’autre côté de”).
Trans* est un terme générique qui désigne toute personne dont l’identité de genre est différente de la norme sociale, comme l’identité cisgenre. En outre, ce terme, suivi de l’astérisque*, est censé inclure les multiples identités qu’il englobe. En fait, sous ce terme générique, nous trouvons un groupe de concepts et de variations : ainsi, “trans*” n’inclut pas seulement les personnes qui sont passées d’un genre à un autre (c’est-à-dire l’ancienne définition de “FtM femme à homme” et/ou “MtF homme à femme”), mais toutes les personnes qui s’identifient à un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. Voici quelques-unes des définitions :
- agenre : une personne qui n’a pas (ou très peu) de lien avec le système traditionnel de genre, qui ne s’aligne pas personnellement sur les concepts d’homme ou de femme, et/ou une personne qui se considère comme n’ayant pas de genre. Parfois appelée “neutre”, “sans genre” ou “genderless”.
- genderfluid : personne qui connaît des fluctuations dans son expression de genre ou son identité de genre, ou les deux.
- Homme transgenre : personne dont l’identité de genre est différente de celle qui lui a été attribuée à la naissance ; s’identifie comme un homme.
- Femme transgenre : personne dont l’identité de genre est différente de celle qui lui a été attribuée à la naissance ; s’identifie comme une femme.
- Non-binaire : personne qui ne s’identifie pas au schéma binaire homme/femme.
- Genderqueer : désigne ou se réfère à une personne qui n’adhère pas aux genres conventionnels présents dans la société.
- Amab ou afab : acronyme signifiant assigned male at birth/ assigned female at birth (assigné à un homme à la naissance/ assigné à une femme à la naissance). Il est utilisé comme expression inclusive pour définir une personne dont le sexe assigné à la naissance est masculin ou féminin, indépendamment de son identité de genre.
Et bien d’autres encore.
Il existe de nombreuses façons d’affirmer et d’embrasser son identité en tant que personne trans*. Par exemple, on peut choisir la thérapie hormonale et/ou la chirurgie d’affirmation du genre comme options, mais la seule chose nécessaire à la validation et au respect de son identité de genre est sa propre détermination et son identification en tant que personne trans*.
Il est important de comprendre le spectre des identités trans* car leur reconnaissance nous aide à clarifier les différences entre l’identité de genre et l’expression de genre et la manière dont nous pouvons passer de l’une à l’autre.
Orientation
L’orientation fait référence aux personnes qui t’attirent, que ce soit sur le plan sexuel ou romantique.
L’orientation sexuelle définit les personnes qui t’attirent sexuellement. Contrairement à l’identité de genre, qui définit ce que tu es, l’orientation sexuelle concerne les personnes vers lesquelles tu te sens physiquement attiré-e. Il existe de nombreux types d’orientation sexuelle. Parmi les plus courantes, on peut citer :
- Hétérosexuel-le : personne attirée sexuellement par un autre genre.
- Homosexuel-le : personne attirée sexuellement par le même genre.
- Bisexuel-le : personne attirée par plus d’un genre.
- Pansexuel-le : personne attirée sexuellement par différentes personnes, quelle que soit leur identité de genre.
- Asexuel-le : personne qui n’éprouve pas d’attirance sexuelle. Les personnes asexuelles peuvent encore éprouver une attirance romantique et vouloir s’engager dans des activités sexuelles, mais elles ne ressentent pas d’attirance sexuelle.
L’orientation romantique définit les personnes qui t’attirent sur le plan émotionnel et affectif. Elle est différente et distincte de l’orientation sexuelle. Même si de nombreuses personnes expérimentent les deux, l’attirance romantique peut exister sans attirance sexuelle. Tout comme l’orientation sexuelle, l’orientation romantique prend de nombreuses formes. Par exemple :
- Hétéro-romantique : personne qui est romantiquement attirée par un autre genre.
- Homoromantique : personne qui est romantiquement attirée par le même genre.
- Biromantique : personne qui est romantiquement attirée par plus d’un genre.
- Panromantique : personne qui est romantiquement attirée par différentes personnes, quelle que soit leur identité sexuelle.
- Aromantique : personne qui n’éprouve pas d’attirance romantique.
- Rappel : les personnes peuvent également éprouver des attirances différentes de l’attirance romantique et/ou sexuelle, par exemple l’attirance sensuelle (désir de contact et de toucher, pas nécessairement des organes génitaux), l’attirance platonique…
Expression de genre
D’accord, mais pourquoi tant d’étiquettes ?
Tous ces mots et définitions peuvent sembler effrayants à première vue. Ils semblent trop nombreux et il est inquiétant de penser que tu dois les garder en mémoire pour être au courant. Ne t’inquiète pas : ce n’est pas ce qu’ils sont censés être. Il n’y a pas d’examen final à passer et il n’y a pas de pièce manquante si tu ne les connais pas tous.
Ces étiquettes sont censées être des outils pour toi, et non des armes contre toi : des outils pour comprendre qui tu êtes, qui tu aimes et comment définir entièrement ton identité sexuelle.
Comme tu le verras dans le module 5, il existe des éléments tels que les “normativités sociales”. Ces normativités sont ces “règles tacites” dans lesquelles nous avons grandi et qui nous induisent en erreur en nous faisant croire qu’il n’y a qu’une seule façon d’être et que tout le reste est simplement hors norme ; ainsi, si tu es cisgenre, hétérosexuel-le, valide, allosexuel-le, blanc-he, mince et riche, tu as plus de chances d’être protégé-e, représenté-e et privilégié-e que les autres. Mais nous venons de voir qu’il y a plus que cela, la réalité est vaste et nuancée. Les étiquettes t’aident à naviguer dans toutes les questions qui peuvent te venir à l’esprit pendant que tu grandis et elles peuvent vraiment être très utiles. Si tu cherches les mots sur Google ou si tu partages l’information avec tes pairs, tu pourras trouver beaucoup de choses qui pourraient te toucher.
La plupart de ces labels sont nés d’une nécessité politique ; la création même d’un nouveau mot de marque implique le besoin de prendre place dans un monde qui n’a pas l’habitude de considérer ton existence entière.
Comme la sexualité elle-même est une découverte sans fin et peut changer au cours de la vie, les étiquettes ne sont pas monolithiques : la plupart des mots qui décrivent ton attirance sexuelle ou romantique, ou ton identité de genre, ne sont pas destinés à te mettre en cage : les étiquettes ne sont pas rigides et elles peuvent changer ; il est tout à fait légitime que tu changes tes sentiments et ton esprit au cours de ta vie : l’étiquetage est compréhensif et non restrictif.
C’est pourquoi il est contre-productif de pratiquer le “gatekeeping”, qui est une action décrivant le fait qu’une personne exclut délibérément une autre parce qu’elle ne correspond pas parfaitement à l’étiquette. Il est compréhensible d’interpréter à tort l’utilisation d’étiquettes comme étant dogmatique (indiscutable, fixe, incontestable), car c’est exactement la façon dont nous avions l’habitude de considérer les catégories dans une société construite sur des normativités. Mais, comme nous l’avons déjà dit, la réalité est plus complexe que cela et il en va de même pour nos sexualités. Le “gatekeeping” est une erreur courante commise par les personnes appartenant ou non à la communauté LGBTQIA+ et c’est quelque chose que nous devons absolument désapprendre. Les mots sont faits pour s’adapter à nous, pas à l’inverse.

Conseils - Suis-je atteint-e de dysphorie de genre ?
La dysphorie de genre décrit le sentiment de malaise et d’inconfort que peuvent ressentir les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Bien que les expériences puissent être différentes d’une personne à l’autre, voici quelques conseils qui peuvent t’ aider à y faire face :
- Exprime tes sentiments – Partage-les avec une personne de confiance ou note-les simplement pour toi-même. N’oublie pas d’y ajouter des pensées positives.
- Trouve l’aide de personnes ayant des sentiments similaires, qu’il s’agisse de tes ami-e-s ou de nouvelles personnes qui peuvent partager leur expérience.
- Trouve/utilise des objets qui t’aident à exprimer ton genre et te donnent confiance en toi, affirmant ainsi ton identité.
- Fais des projets ou des recherches sur la manière de prendre des mesures sociales, médicales et/ou juridiques à court ou à long terme en vue de ton affirmation.
- Si tu identifies des choses quotidiennes qui augmentent ta dysphorie, essaie de les réduire par de petites actions.
- Dis-toi, à haute voix, que ton corps ne définit pas ton genre !
- Essaie de te concentrer sur certaines choses qui pourraient améliorer ton bien-être général (par exemple, le contact avec la nature, l’exercice physique, la lecture, la musique ou toute autre passion ou évasion, un bon sommeil, une alimentation saine).
- Évite les espaces ou les personnes, en ligne et hors ligne, qui te dépriment.
Questions LGBTQIA+ et discriminations de genre
Maintenant que nous avons vu qu’il existe de nombreuses possibilités d’identification et d’orientation, nous voyons plus clairement que les gens peuvent ne pas se reconnaître dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, ou qu’iels peuvent avoir une orientation sexuelle ou romantique plus fluide, ou qu’iels peuvent exprimer des caractéristiques physiques qui ne correspondent pas clairement à l’un ou l’autre genre, et bien d’autres possibilités encore. Ces possibilités sont désignées par le terme de “non-conformité au genre”.
« Plus tard, j’ai commencé à être de plus en plus consciente de mon identité fluide, si bien que je pouvais porter une jupe un jour et un pantalon le lendemain sans trop de problème ; j’ai entamé une relation avec une fille en me sentant mieux acceptée, mais toujours effrayée ».
« Mon enfant de 14 ans est autiste, iel s’habille comme un garçon et s’identifie comme non-binaire. C’est un sujet tabou chez moi et je ne peux pas l’aborder. Iel se dit “garçon”, mais je ne suis pas sûr qu’iel se sente vraiment garçon ».
LGBTQIA+ est un acronyme qui signifie :
– Lesbienne
– Gay
– Bisexuel-le
– Trans*
– Queer et en questionnement
– Intersexe
– Asexuel-les et aromantiques ;
– le signe plus (+) indique que les étiquettes sont toujours en évolution et peuvent être ajoutées ; de nos jours, l’acronyme lui-même est beaucoup plus long car différentes identités ont été reconnues et revendiquées, mais il est très courant de trouver la version abrégée (“LGBTQIA+”) pour se référer à la communauté.
Nous avons décrit ces mots dans le paragraphe précédent, à l’exception du Q qui renvoie à deux termes génériques :
- “Queer” est un terme générique qui englobe toutes les identités divergeant du cisgenre et de l’hétérosexualité. Dans le passé, il s’agissait d’un terme péjoratif signifiant “bizarre”, “étrange”, mais au fil des ans, son utilisation a fait l’objet de nombreux débats, une partie de la communauté se réapproprient ce terme avec fierté et férocité. C’est à toi de décider si tu l’utilises ou non pour te reconnaître : l’essence même de la queerness est en effet que personne d’autre que toi ne devrait te dire quels mots utiliser pour te définir.
- Le “questionnement” est l’acte de réfléchir et de s’interroger sur son identité de genre et/ou son orientation sexuelle et romantique. Comme nous le verrons plus tard, nous vivons dans une société qui considère le cisgenrisme et l’hétérosexualité comme allant de soi, comme des valeurs par défaut. Il se peut que tu ressentes quelque chose de différent, et chaque fois que tu commences à examiner ces sentiments et ces pensées concernant tes identités sexuelles et que tu commences à te demander qui tu es et par qui tu es attiré-e, tu te poses des questions. Le questionnement n’est pas un sceau marquant l’appartenance LGBTQIA+ ou queer : tu peux réaliser que tu es parfaitement à l’aise dans le cisgenrisme et/ou l’hétérosexualité, mais le questionnement n’est pas une prérogative des personnes LGBTQIA+ ; il y a donc de la place pour tout le monde pour s’interroger sur soi-même au-delà de ce que la société te dit d’être.

Conseils - Comment faire son coming out
- Sois en sécurité : Choisis le bon moment pour être le plus en sécurité possible.
- Fais-le à ta manière : Il y a de nombreuses façons de communiquer un coming out : une lettre, une chanson, un appel téléphonique… faire cela “en personne” n’est pas toujours le choix le plus sûr ou le choix qui te met le plus à l’aise – trouve simplement le moyen le plus approprié pour toi !
- Pas de pression : Le coming out est un choix personnel. Il est certain qu’il est important pour l’ensemble de la communauté de faire son coming out et d’être visible, mais cela doit être quelque chose que tu veux faire avant tout.
- Fais confiance à ton réseau : Trouve l’association LGBTQIA+ la plus proche si tu as besoin d’aide pour ton coming out ; si tu as déjà des personnes qui te soutiennent, demande-leur de te soutenir si tu dois faire un coming out plus “difficile”.
Parce qu’iels ne se conforment pas aux normes de genre (voir le module 5 pour en savoir plus sur la normativité), les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+ sont confrontées à la discrimination. La discrimination à l’encontre des personnes de la communauté LGBTQIA+ est appelée homolesbobitransphobie. La marginalisation, la stigmatisation et d’autres formes de discrimination à l’école, sur le lieu de travail, dans le domaine juridique, éducatif et à travers les représentations médiatiques, à l’égard des personnes LGBTQIA+ sont des sujets essentiels à comprendre et à démanteler afin de construire une éducation qui puisse parler à tout le monde, peu importe qui l’on est et qui l’on aime.
« Et puis il y a eu une conversation de 5 minutes sur le fait qu’il est homosexuel, que pour certaines personnes ce fait est un seuil trop élevé, que certaines personnes ne seront pas capables de le surmonter et qu’elles ne voient pas d’autres avantages dans ce fait, elles le voient juste comme un désavantage ».
Les personnes LGBTQIA+ sont confrontées à de multiples risques du simple fait d’être elles-mêmes. Il est essentiel de comprendre que la violence se manifeste sous plusieurs formes, et pas seulement sous la forme de harcèlement ou d’agressions physiques. Lorsque la normativité te rend invisible et marginalisé-e, tu peux avoir l’impression de ne pas exister et donc de ne pas avoir le droit de t’exprimer au mieux.
Outing
On parle d’outing lorsqu’une personne révèle publiquement l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle d’une autre personne sans son consentement. Si tu rencontres quelqu’un-e qui s’ouvre à toi pour te dire qui iel est et qui iel aime, sois sûr-e qu’iel sera en sécurité avec toi : s’iel te dit cela en te demandant de n’en parler à personne d’autre, respecte son besoin car iel est probablement plus en sécurité de cette manière, sans diffuser l’information.
L’outing est différent du coming out :
- une personne LGBTQIA+ fait son coming out lorsqu’elle décide, à son propre rythme et selon ses propres conditions, de parler à tout le monde de son identité ou de son orientation sexuelle et romantique.
- Une personne LGBTQIA+ qui est outée est une personne exposée sans son consentement à propos de sa vie personnelle, sans que ses conditions soient prises en compte et probablement en prenant un risque énorme. Il existe encore de nombreuses discriminations à l’encontre des personnes LGBTQIA+, de sorte que le fait d’être démasqué-e peut te coûter ton emploi, ta sécurité à la maison et à l’école.
Le coming out ne doit jamais être un acte forcé.
Tricking
Un autre acte de violence similaire à l’outing est le “tricking”, qui consiste à forcer la personne appartenant à la communauté LGBTQIA+ à faire son coming out. Le tricking est une manière subtile et manipulatrice de cibler les personnes LGBTQIA+.
En plus, c’est important de préciser que n’est pas nécessaire de faire son coming out pour être reconnu-e comme membre de la communauté LGBTQIA+. Il existe de nombreuses raisons personnelles et contextuelles pour lesquelles tu ne pourrais pas faire ce coming out en toute sécurité et personne ne devrait te pousser à le faire. Ce que tu es et les personnes qui t’attirent sont toujours valables, même si tu ne fais pas ton coming out publiquement. Une communauté vraiment respectueuse est celle qui s’ouvre à un point tel que le coming out lui-même ne devrait pas être nécessaire, parce que toutes les normativités que nous connaissons ont été démantelées et que chacun-e est respecté-e, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle et romantique.
Mégenrer
Il y a du mégenrage lorsque quelqu’un-e s’adresse de manière répétée et/ou délibérée aux personnes trans* (selon la définition large mentionnée plus haut) en utilisant les mauvais pronoms.
Les pronoms sont des mots que nous utilisons à la place d’un prénom. Par exemple:
- Il/lui est un ensemble de pronoms genrés qui sont souvent associés aux hommes ou aux garçons ou à ceux qui s’identifient comme tels.
- Elle/elle est un ensemble de pronoms genrés qui sont souvent associés aux femmes, aux filles ou à celles qui s’identifient comme telles.
- Iel/ille/ael/ellui est souvent considéré comme un ensemble de pronoms neutres, souvent utilisé pour une personne qui ne s’identifie pas à un genre spécifique.
Ce ne sont que quelques exemples, mais il existe de nombreux autres pronoms neutres, tels que les néo pronoms comme al/ol/ul. Quelle que soit l’identité de genre, tous les pronoms peuvent être utilisés pour n’importe quel genre et sont neutres. Néanmoins, beaucoup de personnes non-binaires et trans* choisissent d’utiliser les pronoms anglais they/them/ze/zi pour se définir. Les pronoms font partie intégrante de notre identité et le fait de partager ses pronoms ou de demander ceux d’une autre personne permet non seulement d’affirmer son identité, mais aussi de créer un environnement plus inclusif et plus respectueux pour tous-tes. Nous pouvons souligner l’idée suivante : Utiliser les pronoms avec lesquels les gens s’identifient est une façon de montrer du respect pour leur identité de genre.
Les prénoms et pronoms choisis sont ceux que les personnes trans* choisissent pour exprimer leur identité et devraient toujours être respectés. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi : des personnes peuvent être mal à l’aise avec ton identité et refuser de respecter ton prénom ou tes pronoms afin d’établir leur point de vue au détriment du tien ; c’est de la discrimination transphobe active. Bien sûr, toutes les personnes qui se trompent de prénom ou de pronom ne le font pas exprès : il s’agit de s’y habituer et de se rappeler les bons, mais il est important de faire l’effort de les apprendre et de les mémoriser.
Passing
Dans le contexte des personnes LGBTQIA+, le passing signifie passer pour quelqu’un-e qui n’appartient pas à la communauté LGBTQIA+. Le passing est basé sur des attentes stéréotypées liées au genre et sur des normativités sociales. Par exemple : ton orientation sexuelle et/ou romantique n’est pas hétérosexuelle/hétéroromantique. Étant donné que nous ne nous promenons pas avec une cible sur nous expliquant “Je suis bisexuel-le/pansexuel-le/asexuel-le” (ou biromantique, panromantique, aromantique…), les gens supposeront que tu es hétérosexuel-le/hétéro-romantique parce que tu passes pour tel-le, puisque la norme donnée par défaut est l’hétérosexualité.
Les choses deviennent plus compliquées et plus dangereuses lorsqu’il s’agit des personnes trans* : pour celles qui entament une démarche d’affirmation (médicale, hormonale, chirurgicale), il peut arriver que leur corps change en raison de la thérapie ; ces changements les exposent à un jugement constant de la part d’autres personnes, qui les prennent pour cible. Ce n’est pas seulement injuste (personne n’a le droit de juger l’apparence d’autrui), mais dangereux pour elleux dans une société qui commence maintenant à comprendre les existences au-delà du binaire de genre et des expressions de genre stéréotypées.

Conseils pour créer des environnements inclusifs pour les personnes LGBTQIA+
Voici quelques étapes à suivre pour rendre votre école ou tout autre environnement social dans lequel tu passez du temps plus
inclusif :
- Supprimer les lieux “genrés”, basés sur la norme binaire du genre, comme par exemple les toilettes de l’école.
- Demandez les pronoms des personnes que tu n’as jamais rencontrées (il est utile de se présenter avec nos pronoms, même si nous sommes cis).
- Organiser des activités sur les questions LGBTQIA+, en incluant toujours les personnes LGBTQIA+ dans le processus de co-création de ces événements.
- Dénoncer les comportements discriminatoires en expliquant pourquoi ils posent problème. Fais-le en toute sécurité !
- Établir ou proposer des protocoles pour répondre aux comportements discriminatoires, conçus en collaboration avec les membres de la communauté LGBTQIA+.
- Adopter une proposition juridique visant à reconnaître les prénoms et pronoms choisis comme légitimes dans les documents personnels et professionnels (par exemple, en Italie, une mesure telle que la “carriera alias” permet aux étudiants trans* de signer leurs examens lors de leur inscription).
Les personnes racisées et LGBTQIA +
« C’est difficile d’être musulmane, arabe et lesbienne, car les gens ne comprennent pas. J’ai de la chance que ma famille m’accepte ».
Comme dans beaucoup d’autres environnements, y compris dans la communauté LGBTQIA +, les personnes racialisées sont confrontées à des discriminations intersectionnelles : le racisme et l’homolesbobitransphobie (voir le module 5 pour en savoir plus sur l’intersectionnalité). Cela est dû à une représentation limitée et à des stéréotypes basés sur le sexisme et le racisme qui entraînent une fétichisation, une invisibilisation et une exclusion raciale. Pourtant, la lutte contre la LGBTQ+phobie et le racisme semble déconnectée.
« Les gays ont la réputation d’être féminins, et les noirs d’être trop masculins et violents, donc les gens ne peuvent pas me voir comme les deux à la fois ».
En ce qui concerne les hommes gays, Damien Trawalé, sociologue et chercheur sur les discriminations vécues par les hommes noirs en France, explique que contrairement aux représentations des hommes perçus comme noirs, qui sont hypersexualisés et sur-virilisés, celle de l’homosexualité des hommes est souvent vulnérabilisée, fragilisée et féminisée. En lien avec cela, il y a le racisme et la fétichisation raciale dont sont victimes de nombreux hommes gays sur les applications de rencontre. Sur son profil Instagram (@pracisees_vs_grindr), Miguel Shema dénonce ce type de discrimination.
« Nous, qui ne sommes pas blanc-he-s, ne sommes représenté-e-s dans aucune des deux communautés ».
La lutte des LGBTQIA+ est également souvent instrumentalisée pour mener à bien des réformes racistes et anti-migratoires. On peut parler d’homonationalisme. Certains partis politiques européens (souvent d’extrême droite, mais pas exclusivement) affirment que les migrant-e-s et les personnes racisées ne partagent pas les mêmes valeurs que les pays européens et occidentaux en termes de liberté individuelle des personnes socialisées en tant que femmes et LGBTQIA+, et les criminalisent dans le discours public en tant qu’auteur-rice-s potentiel-le-s de comportements misogynes et homolesbobitransphobes. Il en va de même pour le fémonationalisme : l’instrumentalisation des luttes féministes à des fins racistes, par exemple dans la rhétorique islamophobe contre le hijab.
En réalité, il existe de nombreux environnements sociaux qui ne font pas partie de “l’Occident”, dans lesquels les récits autour de la binarité du genre sont beaucoup moins rigides et plus fluides que les récits occidentaux.
Le rôle des réseaux sociaux dans la compréhension du genre
« C’est assez drôle, mais c’est probablement sur TikTok que j’ai le plus appris. Parce que… parce qu’il y a des gens de différentes parties du monde qui publient du contenu, et iels parlent de toutes sortes de sujets, donc tu vois différentes personnes parler, et certaines d’entre elles essaient d’éduquer les autres, d’autres font ce genre de blagues TikTok, comme des blagues sur les stéréotypes, donc c’est un peu comme ça que j’ai eu l’idée, et puis d’une manière ou d’une autre je finis par lire et apprendre sur ces sujets moi-même, mais la première source a été
TikTok ».
Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, il existe aujourd’hui davantage d’opportunités d’entrer en contact avec des expériences, du matériel et des histoires qui t’aident à ouvrir largement tes idées sur la signification du genre. Les témoignages directs donnés sur les réseaux sociaux (par le biais de messages écrits sur Facebook et Instagram, ou de vidéos sur TikTok) permettent aux membres de la communauté LGBTQIA+, mais aussi à celleux qui n’en font pas partie, d’avoir des idées plus claires sur ces sujets dans une perspective de compréhension, ce qui facilite deux choses principales :
- Les personnes qui commencent à entrer en résonance avec la communauté se sentent vues et incluses.
- Celleux qui appartiennent aux normativités apprennent et démystifient certains des stéréotypes et des préjugés mentionnés précédemment.
« Les informations ont été principalement trouvées sur Internet, auprès d’ami-e-s, et maintenant à l’école. Récemment, cette année seulement, lae professeur-e de SVT a commencé à parler du genre, de la façon dont les gens peuvent s’identifier différemment du sexe avec lequel iels sont né-e-s, et qu’il y a des personnes intersexuées, et que l’on peut aimer le même genre, pas le même genre, des choses comme ça…»
Comme mentionné ailleurs dans ce guide, Internet est un lieu à multiples facettes où nous apprenons encore à nous comporter et à coexister, et ce n’est pas toujours un endroit sûr (voir plus à ce sujet dans le module 3 – Violences sexistes et sexuelles). En même temps, heureusement, il y a de plus en plus de représentations positives de personnes en dehors des normes de genre (par exemple Theo Putnam dans Chilling Adventures of Sabrina, de nombreux personnages dans Sex Education, etc.) De plus en plus de célébrités font leur coming out et assument également ce rôle de représentation : Bilal Hassani, Moon (Drag Race France), Sam Smith, Kim Petras, M.J. Rodriguez (Pose), etc. Par ailleurs, il existe de nombreuses structures locales et nationales pour soutenir les personnes LGBTQIA+ dans leurs transitions, en les aidant à s’éloigner de situations domestiques abusives, ou en leur donnant tous les outils et informations pour mieux comprendre et reconnaître leurs besoins. Plus les gens seront en contact avec ces représentations, plus il leur sera facile de comprendre et d’accepter les différences qui les entourent.
Nous manquons encore de représentations queer, et surtout de représentations positives, où les personnages queer ne se limitent pas à leur sexualité et/ou à leur identité de genre. Il est tout aussi important de montrer que ces éléments ne les définissent pas complètement, et que leur vie n’est pas faite que d’obstacles et de discriminations.
Références
2021 equity challenge day 3: what is privilege? (n.d.). United way for Southeastern Michigan. Retrieved 5 February 2023 from https://unitedwaysem.org/equity_challenge/day-3-what-is-privilege/
Alsop, R., Fitzsimons, A., Lennon, K. (2002). Theorizing Gender. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.
Balocchi, M. (2019). Intersex. Antologia multidisciplinare. Pisa: Edizioni ETS.
Elan Interculturel et al., (2023). Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en contexte interculturel. Retrieved 20 December 2023 from https://e.pcloud.link/publink/show?code=CsaotalK
Gender binary. Oxford dictionary. Retrieved 5 February 2024 from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gender-binary?q=gender+binary
Interact Advocates for Intersex People et al (n.d). What is Intersex? Last retrieved 20 January 2024 from https://interactadvocates.org/.
Kassel G. (2023). Understanding the gender binary. Healthline. Retrieved 5 February 2024 from https://www.healthline.com/health/gender-binary
KidsHealth. (2023). Coping with gender dysphoria. Last retrieved 1 February 2024 from https://www.kidshealth.org.nz/coping-gender-dysphoria
Mady, G. (2020). A Quick & Easy Guide to Queer & Trans Identities. Oni-Lion: Forge Publishing Group.
Patriarchy (n.d). Sciencedirect. Retrieved 5 February 2024 from https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/patriarchy
Planned Parenthood, https://www.plannedparenthood.org/learn/teens. Last retrieved 10 January 2024
UNESCO, et al. Revised edition of the International Technical Guidance on Sexuality Education. Paris. Retrieved 3 November 2023 from: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf
Vaid-Menon, A. (2020). Beyond the gender binary. New York: Penguin Books.





