
Dans ce module, nous explorerons les principales normes culturelles en matière de sexualité et de relations. En gardant une approche intersectionnelle, nous parlerons des différentes formes de discrimination systémique, de l’influence des médias sur notre perception du corps et de l’influence de la religion sur notre sexualité.
Voices - Module 5
Introduction
Nos expériences en matière de sexualité et de relations sont profondément influencées par la culture dans laquelle nous vivons. La culture est composée de toutes les normes et attentes sociales qui contribuent à la façon dont nous percevons et expérimentons le monde.
Toutes les cultures ont des normes sexuelles qui définissent l’éventail des comportements sexuels acceptables. Ces normes peuvent être plus ou moins en phase avec nos besoins et nos désirs en matière de sexualité, elles évoluent avec le temps et les générations, mais elles n’en influencent pas moins nos choix. Les normes sexuelles peuvent porter sur de nombreux sujets différents, tels que le mariage, la virginité, les identités de genre, la chasteté, les idées de beauté et d’attirance, les pratiques sexuelles, etc.
La religion, par exemple, influence grandement les codes moraux en matière de sexualité et ce qui est considéré comme acceptable. Comme nous l’avons vu dans les modules précédents, les normes relatives au genre influencent ce que les jeunes apprennent sur la sexualité en fonction du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Ou encore, les médias et la représentation qu’ils donnent des corps et des relations affectent également ce que nous considérons comme attirant ou désirable. Ces normes et habitudes culturelles contribuent à la construction de stéréotypes et à la discrimination qui en découle. Étant donné que nos identités sont multiples, les personnes peuvent être confrontées à plusieurs niveaux de discrimination à la fois. Le terme que nous utilisons pour désigner cette pluralité d’oppressions entrelacées est l’intersectionnalité.
Vocabulaire clé et définitions

Normativité
Le phénomène par lequel la société construit certaines actions, comportements, manières d’être comme normales et donc bonnes, souhaitables, coutumières, référentielles. Par contraste, d’autres actions, comportements, manières d’être deviennent mauvaises, atypiques, irrégulières, indésirables et construites comme altérités.
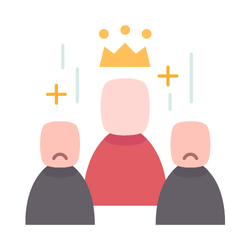
Privilège
Le privilège est un accès non mérité ou des avantages accordés à des groupes spécifiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe social. Les privilèges peuvent être basés sur une variété d’identités sociales telles que la race, le sexe, la religion, le statut socio-économique, les capacités, la sexualité, l’âge, le niveau d’éducation, etc.

Préjugé
Appréciation, jugement et/ou opinion non-fondés et déformés d’un groupe social, d’une communauté, d’une culture ou d’une religion. Il s’agit de processus de pensée, basés sur des stéréotypes, qui peuvent avoir un impact sur le comportement et donc entraîner une discrimination active. Les préjugés peuvent être implicites ou explicites ; ce sont les processus de pensée inconscients (lorsqu’ils sont implicites) ou conscients (lorsqu’ils sont explicites) qui se situent entre un stéréotype et une discrimination active.

Stéréotype
Une fausse croyance, souvent partagée collectivement, et intériorisée dans la conscience collective. Les stéréotypes s’expriment par l’exagération ou l’extrapolation de plusieurs caractéristiques attribuées à certains groupes sociaux. Ils sont facilement véhiculés et établis comme des vérités générales.
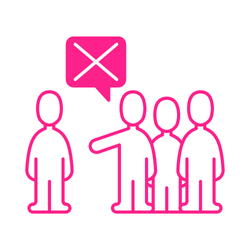
Discrimination
Traitement défavorable attribué à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance supposée à un groupe, dans le but de les exclure. Selon la sociologue Véronique de Rudder, la discrimination est “l’application d’un traitement différent et inégal à un groupe ou à une communauté, sur la base d’un trait ou d’un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement construits comme un stigmate”.
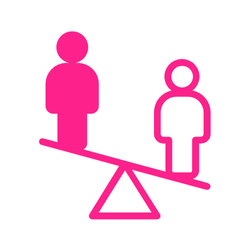
Discrimination systémique
Une discrimination cumulative, récurrente et historiquement construite. Elle peut se perpétuer à plusieurs niveaux : individuel (micro), collectif (mezzo) et/ou institutionnel (macro/structurel). Ainsi, une approche systémique des discriminations se situent autant dans les rapports sociaux (de sexe, de genre, de race etc) que dans les relations sociales entre les individu-e-s. Par exemple, une discrimination systémique au niveau institutionnel est le difficile accès pour les femmes dans les postes à hautes responsabilités.

Agisme
Discrimination fondée sur l’âge d’une personne. Elle touche aussi bien les jeunes que les personnes âgées.

Classisme
Discrimination selon la classe sociale visant à marginaliser certain-e-s individu-e-s qui appartiendraient à une classe dite “inférieure”. La division du monde social sur un mode classiste positionne les classes supérieures et bourgeoises en opposition aux classes supposément inférieures et pauvres. Une personne issue d’une famille historiquement puissante ou d’un ménage aux revenus plus élevés sera considérée comme supérieure à une autre.
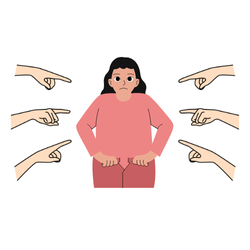
Grossophobie
Comportements et attitudes discriminatoires visant à marginaliser et à exclure les personnes perçues comme grosses et/ou obèses de la société.

Racisme
Système de pouvoir s’appuyant sur l’idée qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains avec des groupes “supérieurs” et des groupes “inférieurs” en raison de leur groupe racial supposé. Cela s’exprime notamment par la multiplicité des actions, conscientes et inconscientes, visant à discriminer, exclure et intérioriser les groupes supposément “inférieurs”. Cette définition du racisme naît donc de la théorie des races pour justifier la colonisation, l’esclavage et la domination blanche.

Discrimination religieuse
Discrimination fondée sur les croyances religieuses d’une personne. Les formes les plus courantes de discrimination religieuse sont l’antisémitisme, qui touche les juif-ve-s, et l’islamophobie, qui touche les musulman-e-s.

Islamophobie
Modalité d’expression du racisme désignant la peur envers l’Islam et plus généralement envers les personnes perçues comme arabes et/ou musulmanes. Peur qui se matérialise notamment par une haine raciale de ces populations et par le biais de multiples stigmatisations, discriminations, visant à les inférioriser et à les exclure.

Antisémitisme
Modalité d’expression du racisme envers les personnes juives et/ou perçues comme telles. “L’antisémitisme […] a pour noyau la croyance que les juifs – tous les juifs, et partout – sont partie intégrante d’une conspiration décidée à ruiner puis dominer le reste de l’humanité.” (Cohn, 1967). Ces croyances donnent lieues à des images, des mythes et des idéologies qui entraînent une discrimination sociale ou légale. Les actes violents, attitudes, actions, et mobilisations politiques qu’elles soient individuelles, collectives ou étatiques, ont pour conséquence de mettre à l’écart, de déplacer ou de détruire les Juifs-ves en tant que Juifs-ves (Fein, 1987).

Sexisme
Système de croyance fondé sur la prétendue supériorité des hommes sur les femmes pour des raisons biologiques, et qui influence les rôles que les femmes et les hommes peuvent jouer dans notre société.

Xénophobie
Peur et comportement de rejet ou d’hostilité à l’égard de ce qui est considéré comme “étranger” ou inconnu.
Le racisme et la xénophobie pouvant parfois être confondus, il convient de se poser deux questions pour savoir de quel phénomène
– Ce qui se passe est-il le résultat de la colonisation ou de la domination blanche (racisme) ?
– Ce qui se passe relève-t-il d’une peur de l’inconnu ou d’être menacé (xénophobie) ?
Source : Page Instagram / Racisme Invisible

Race
La race n’existe pas au sens biologique et naturel que lui attribuent les racistes. Cependant, elle existe socialement en tant que régime de pouvoir. Parler de race, c’est qualifier la manière dont les hiérarchies continuent à être produites, et préciser qu’elles le sont sur la base de l’origine réelle ou supposée des individu-e-s : on parle ainsi de catégories raciales (personnes perçues comme noires, arabes, asiatiques…). Le recours à cette notion est d’autant plus nécessaire dans l’Europe actuelle qui nie l’existence du racisme “en étant aveugle à la couleur”.

Minorités / groupes minoritaires
Représentent les groupes en situation de moindre pouvoir dans les sphères juridiques, politiques et économiques. Une distinction est faite entre les minorités raciales (personnes racialisées) et les minorités de genre (femmes) et/ou d’orientation sexuelle LGBTQIA+).

Racisé-e-s / personnes racialisées
Notion introduite par l’anthropologue et sociologue Colette Guillaumin dans les années 1980 dans son ouvrage L’idéologie Raciste : Genèse et Langage actuel (1982). Les personnes racisées sont celles qui sont touchées par les processus de stigmatisation et d’exclusion du racisme. L’auteur distingue deux catégories : les groupes minoritaires (racisés, non-blancs) et les groupes majoritaires (dominant, blancs, universels).
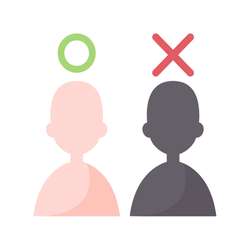
Processus de racisation / racialisation
Des pratiques de pouvoir visant à hiérarchiser les individu-e-s sur la base de leur race supposée. Ces processus incarnent l’ensemble des mécanismes d’exclusion auxquels sont soumises les minorités raciales. Dans cette perspective, utiliser les termes de personnes “blanches” et personnes “non-blanches” désigne la position sociale que les un-e-s et les autres occupent au sein de ces processus de racisation. Il ne s’agit pas à proprement parler de désigner la couleur de peau d’un-e individu-e.

Groupes majoritaires / dominants
Représentent les groupes en situation de plein pouvoir dans les domaines juridiques, politiques et économiques (personnes perçues comme cis, blanches, valides et hétérosexuelles). Au sommet de la hiérarchie sociale se trouvent les hommes blancs, hétérosexuels et appartenant à la classe moyenne.
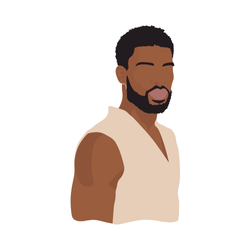
Fétichisme racial
Modalité d’expression du racisme visant à s’intéresser affectueusement, intimement et/ou sexuellement aux personnes non-blanches, notamment, à travers la pluralité des stéréotypes de sexe et de race véhiculés depuis l’époque coloniale. Par exemple, l’imaginaire animalier associé à certaines femmes noires comme “tigresses” ou “lionnes” ou encore la supposée endurance illimitée des hommes noirs. Le fétichisme racial est très souvent un processus intériorisé par certain-e-s individu-e-s des groupes majoritaires – mais pas que – et représente un véritable danger pour les personnes qui en font l’objet.

Intersectionnalité
En sociologie, une approche intersectionnelle revient à considérer la pluralité des oppressions et discriminations comme imbriquées, articulées et non cumulatives ou additionnées. En 1979, le Combahee River Collective, collectif de femmes noires américaines, va parler de « interlocking system of oppression » (systèmes d’oppressions imbriqués) pour décrire les différentes oppressions dont elles font l’objet ; le système raciste, capitaliste, patriarcal et hétérosexuel. En 1989, Kimberley Crenshaw, juriste noire, théorise la notion pour définir la situation de certaines travailleuses noires syndicalistes. Elles font face à des difficultés. Le syndicat considère que pour représenter des noirs, il faut des hommes et pour représenter des femmes, il faut des blanches. Elles, femmes noires, tombent alors dans une zone impensée, une zone grise.

Pornographie
La pornographie désigne tout matériel sexuellement explicite – écrit, visuel ou autre – destiné à exciter sexuellement. La pornographie peut devenir une source d’exploration de soi, nous permettant de comprendre nos préférences et nos désirs ; en même temps, elle peut aussi être l’une des sources d’information les plus inexactes, en particulier lorsqu’aucune EVAS n’est fournie, car elle peut nous faire penser que ce qui se passe dans la pornographie devrait se produire dans les rapports sexuels personnels.

Virginité
Concept social et culturel lié à l’expérience sexuelle d’une personne, généralement associé à l’état de n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec pénétration (rapports sexuels pénis-vagin). Le concept de virginité est subjectif et peut varier selon les cultures et les systèmes de croyance, mais il est souvent associé aux attentes et aux normes de la société en matière de comportement sexuel.

Image du corps
C’est ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir, ce que nous pensons et ressentons à propos de notre corps, comment les autres nous voient et comment la société nous dit que nous devrions paraître, qui implique souvent de vivre son propre corps avec des préoccupations et des pressions.

Positivité corporelle
Ce mouvement prône l’acceptation de chaque corps, indépendamment de sa taille, de sa forme, de la couleur de sa peau, de son sexe ou de ses capacités physiques. Ses partisans mettent davantage l’accent sur le bien-être holistique du corps humain que sur son apparence extérieure. En tant que concept, il est né au sein du Fat Rights Movement (mouvement pour les droits des gros-se-s), qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 1960 pour l’acceptation des corps gras, puis s’est développé en embrassant une idée plus large des corps non-conformes, mais des critiques sont exprimées de nos jours puisque nous ne pouvons pas nous sentir positif-ve-s en permanence : les forces qui façonnent notre image de nous-mêmes vont au-delà de notre propre volonté, mettre l’accent sur le changement individuel et l’amour de soi et pas assez sur l’oppression systémique peut réitérer le message, de sorte que la positivité corporelle peut devenir un autre fardeau pour les gens.
Normativité culturelle et discriminations intersectionnelles
Dans notre société, il existe certains éléments qui, afin de rendre les interactions et les relations aussi simples que possible, sont “considérés comme allant de soi” ; ils en viennent ainsi à être constitués en “normes”, en hypothèses de base sur la base desquelles le monde est perçu.
La normativité est donc le phénomène par lequel nous considérons certaines choses (actions, comportements, manières d’être) comme “normales” et donc bonnes, souhaitables, régulières, le point de départ. Par contraste, d’autres choses (actions, comportements, manières d’être) deviennent conformes, atypiques, irrégulières, indésirables et construites comme altérités. Bien qu’il puisse sembler réconfortant d’avoir des normes et des règles qui nous régulent dans la compréhension de ce que nous devrions être comment agir, dans notre société, cela a toujours conduit à différentes couches et formes d’oppressions pour celleux qui ne se reconnaissent pas dans ces normativités.
Voici quelques-unes des normes les plus puissantes et les plus oppressives, classées par ordre alphabétique :
- Allo-normativité : le point de vue des personnes allosexuelles et alloromantiques – celles qui éprouvent une attirance sexuelle et/ou romantique – comme étant la norme.
- Androcentrisme : le point de vue des hommes est considéré comme la norme.
- Cis-normativité : la perspective des personnes cisgenres – celles qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance – comme la norme.
- Hétéronormativité : la perspective des personnes hétérosexuelles – celles qui sont attirées par d’autres personnes du genre “opposé” – comme étant la norme.
- Mono-normativité : la perspective des personnes monogames – celles qui vivent la monogamie comme une orientation relationnelle – comme la norme.
- Normativité blanche : la blancheur est l’identité raciale considérée comme la norme.
- Occidentalocentrisme : la perspective des cultures occidentales en tant que norme.
- Validisme : la perspective des personnes valides – celles qui n’ont pas de handicap – est la norme.
La liste est encore longue de toutes ces “normes” dans lesquelles nous grandissons en tant que règles sociales tacites, qui marginalisent et rendent invisibles les personnes qui ne s’y conforment pas.
Les normes posent la question de pouvoir et de ses détenteur-rice-s dans la société. Nous avons mentionné le patriarcat dans le module 2 et nous disposons maintenant de termes supplémentaires pour étendre et comprendre les liens et les enchaînements : si l’hégémonie est détenue par des hommes, nous pouvons mieux comprendre que nous parlons d’hommes allo-, cis-, hétéro-, mono-, blancs, valides. Bien sûr, cela ne signifie pas que les personnes qui correspondent aux catégories hégémoniques sont mauvaises en soi : c’est simplement la façon dont la société est construite, qui avantage certain-e-s au détriment d’une multitude. C’est ce qu’on appelle le privilège. Tous-tes celleux qui ne rentrent pas dans ces cases ont moins de privilèges que celleux qui y rentrent : cela signifie qu’iels sont moins visibles, moins entendu-e-s, moins considéré-e-s et moins protégé-e-s. Une éducation normative dans ce sens implique qu’il n’y a pas de place pour les personnes et les identités qui ne correspondent pas aux “normes”. C’est préjudiciable lorsque l’on grandit et que l’on se sent peut-être un peu différent-e, parce que l’on n’en parle pas, que l’on n’a pas de références ou de représentations. Lorsque quelque chose est passé sous silence, cela peut s’avérer dangereux.
Les normativités produisent des stéréotypes, des préjugés et des discriminations :
Comme nous l’avons vu dans le module 2, les stéréotypes sont des idées généralisées et simplifiées à l’extrême d’une certaine catégorie de personnes qui sont construites par la société. Par exemple : les femmes ne peuvent pas conduire ; les filles masculines sont lesbiennes ; les personnes bisexuelles sont confuses ; les hommes noirs sont bons au basket-ball.
Les préjugés sont des jugements déformés, des opinions préconçues contre ou en faveur de quelque chose ou de quelqu’un-e qui ne sont pas fondées sur des expériences réelles. Ce sont des processus de pensée, basés sur des stéréotypes, qui peuvent avoir un impact sur le comportement et donc entraîner une discrimination active. Par exemple :
- Si tu as une opinion négative du travail de tes collègues qui s’identifient comme des femmes, il s’agit d’un préjugé fondé sur le stéréotype selon lequel les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Et si tu embauches plus d’hommes que de femmes, bien qu’iels aient un cursus équivalent, cela devient une discrimination active.
- Si tu te sens mal à l’aise en présence de personnes trans* sans les connaître personnellement, il s’agit d’un préjugé fondé sur le stéréotype selon lequel les personnes trans* sont étranges ou perturbées. Si tu légifères ensuite sur leur vie en les excluant du sport, de l’accès aux soins de santé, de leur lieu de travail et de l’école, en raison de cette croyance, cela devient de la discrimination active.
Et ainsi de suite.
En d’autres termes, les préjugés sont les processus de pensée inconscients (lorsqu’ils sont implicites) ou conscients (lorsqu’ils sont explicites) qui se situent entre un stéréotype et une discrimination active. Nous grandissons avec des préjugés, ils font partie des récits créés par les normativités. C’est pourquoi la discrimination n’est pas nécessairement intentionnelle : si tu es une personne qui se considère et qui est perçuereconnue dans une ou toutes les normativités, tu n’as pas besoin de haïr une autre personne (qui est en dehors d’une ou de toutes les normativités) pour la discriminer. Les préjugés peuvent être implicites ! La clé pour comprendre comment les normativités sociétales peuvent affecter une personne ou un groupe de personnes est de réaliser qu’il s’agit de récits dans lesquels nous vivons et, aussi simplement que possible, tant que nous ne sommes pas confronté-e-s et conscient-e-s de la manière dont ils créent une hiérarchie entre les êtres humains, il est facile de s’y habituer et de ne pas les reconnaître. Il est de la responsabilité de chacun de reconnaître et d’apporter un changement, étape par étape.
Les formes les plus courantes de discrimination sont les suivantes :
- Le sexisme – discrimination fondée sur le genre d’une personne. Il touche les femmes et les personnes queers.
- L’homo-lesbo-bi-transphobie – discrimination fondée sur l’orientation sexuelle d’une personne. Elle touche les personnes non hétérosexuelles.
- Le racisme – discrimination fondée sur la race* d’une personne. Elle touche les personnes non-blanches.
- Le classisme – discrimination fondée sur la classe sociale d’une personne. Elle touche les personnes issues de milieux socio-économiques plus défavorisés.
- Le validisme – discrimination fondée sur les capacités mentales ou physiques d’une personne. Elle touche les personnes en situation de handicap.
- La grossophobie/fatphobie – discrimination fondée sur le poids d’une personne. Elle touche les personnes obèses, grosses ou en surpoids.
- L’âgisme – discrimination fondée sur l’âge d’une personne. Elle touche les jeunes et les personnes âgées.
- La discrimination religieuse – discrimination fondée sur les convictions religieuses d’une personne. Les formes les plus courantes de discrimination religieuse sont l’antisémitisme, qui touche les juif-ive-s, et l’islamophobie, qui touche les musulman-e-s.
Les personnes qui appartiennent à plusieurs de ces catégories sont souvent confrontées à plusieurs niveaux de discrimination à la fois. Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit de l’intersectionnalité. En sociologie, une approche intersectionnelle consiste à considérer la pluralité des oppressions et des discriminations comme imbriquées, articulées et non-cumulatives ou additives. En 1979, le Combahee River Collective, un groupe de femmes noires américaines, a inventé le terme “interlocking system of oppression” pour décrire les différentes oppressions auxquelles elles étaient soumises : racistes, classistes, sexistes et homophobes. En 1989, Kimberlé Crenshaw, avocate noire, a théorisé la notion pour définir la situation de certaines femmes noires syndicalistes : le syndicat considérait que les hommes noirs étaient les mieux placés pour représenter les Noirs et que les femmes blanches étaient les mieux placées pour représenter les femmes. Les femmes noires se retrouvaient donc dans une zone grise inexplorée.
L’intersectionnalité est la reconnaissance du fait que chacun-e a sa propre expérience de la discrimination et de l’oppression et que nous devons tenir compte de tout ce qui peut marginaliser les gens – le genre, la race, la classe, l’orientation sexuelle, les capacités physiques/cognitives, etc.
Une femme noire peut être victime de misogynie et de racisme, mais elle vivra la misogynie différemment d’une femme blanche et le racisme différemment d’un homme noir, ce que nous appelons la misogynie noire ou la misogynoire.
La discrimination systémique est une discrimination cumulative, récurrente et historiquement construite. Elle peut se perpétuer à plusieurs niveaux : individuel (micro), collectif (mezzo) et/ou institutionnel (macro/structurel). Elle est fondée sur des relations sociales (sexe, genre, race, etc.). La discrimination systémique implique les procédures, les routines et la culture organisationnelle de toute organisation qui, souvent sans intention, contribuent à des résultats moins favorables pour les groupes minoritaires que pour la majorité de la population, à partir des politiques, des programmes, de l’emploi et des services de l’organisation.
Image corporelle : représentation et remise en question des normes
Tous les corps sont beaux ! Pourtant, notre relation avec notre image corporelle et sa perception n’est pas si simple. En effet, les normativités et les discriminations dont nous avons parlé précédemment sont vécues et mises en œuvre par les personnes principalement à travers leur corps.
Notre image corporelle est ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir, ce que nous pensons et ressentons à propos de notre corps, comment les autres nous voient et comment la société nous dit que nous devrions avoir l’air. Nous sommes tous-tes confronté-e-s à des préoccupations et à des pressions concernant notre apparence corporelle, que ce soit pour nous sentir plus désirables, plus accepté-e-s ou plus en sécurité. Certain-e-s d’entre nous plus que d’autres, selon que leur corps est plus ou moins conforme à ce qui est culturellement considéré comme beau, désirable et accepté.
La représentation médiatique des corps et les images corporelles que nous voyons ont une grande influence sur nos idéaux corporels. Dans les médias grand public, les corps sont souvent : blancs, grands, minces, valides, avec une peau plus claire, appartenant à un des deux genres binaires. Ils sont ancrés dans la normativité et peuvent impliquer des discriminations, notamment la grossophobie, le validisme, la négrophobie et les structures patriarcales. En conséquence, les gens sont non seulement marginalisés, mais aussi menacés voire tués pour leur apparence, et ce également parce que les personnes obèses ou en surpoids, les personnes handicapées les personnes noires, les personnes queers, et bien d’autres encore, trouvent rarement un espace de représentation qui aille au-delà d’une représentation stéréotypée. Par exemple, les personnes grosses sont considérées comme paresseuses, les personnes noires comme des criminel-le-s, les personnes handicapées comme des êtres non sexuels, les personnes transgenres comme des prostituées, etc. Les images strictes du corps ont un impact profond sur la santé mentale des gens et provoquent souvent des troubles alimentaires tels que la boulimie ou l’anorexie, la dépression et une faible estime de soi.
Alors, comment s’attaquer à ce problème ?
Un concept que l’on entend souvent lorsqu’on parle de corps est celui de la “Body Positive” (positivité corporelle). La positivité corporelle peut être définie comme l’attitude qui consiste à embrasser, accepter et apprécier son corps tel qu’il est. En d’autres termes, croire que “tous les corps sont beaux”. En tant que concept, il est né au sein du Fat Rights Movement (“Mouvement pour les droits des personnes grosses”) qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 1960 pour l’acceptation des gros corps. Il s’est ensuite développé pour englober une idée plus large de corps non conformes. Aujourd’hui, le mouvement body positive est devenu très courant et communique beaucoup par le biais des réseaux sociaux, motivant les gens à se sentir bien dans leur peau et dans leur apparence.
S’il est important pour chacun-e d’entre nous de travailler sur la façon dont nous nous sentons par rapport à notre propre corps, il est également important de se rappeler que nous ne pouvons pas nous sentir bien dans notre corps tout le temps. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les forces qui façonnent l’image que nous avons de nous-mêmes vont au-delà de notre propre volonté. L’inconvénient du discours body positive est qu’il est trop axé sur le changement individuel et l’amour de soi et pas assez sur l’oppression systémique. Ainsi, la positivité du corps peut devenir un autre fardeau pour les gens. C’est comme si la société disait : “ton corps n’est pas considéré comme suffisamment bon, mais tu dois aussi t’aimer toi-même, et si tu ne le fais pas, c’est que tu ne fais pas assez d’efforts”. Dans ces cas-là, n’oublie pas que tu aimeras parfois ton corps et parfois non. Essaye donc d’être gentil-le avec toi-même et rappelle-toi qu’il y a aussi des structures systémiques d’oppression en jeu. Cela signifie-t-il que tu ne peux rien faire ? Non !

Conseils pour remettre en question les idéaux et les normes corporelles
- Prête attention aux corps que tu vois : quels sont les corps présents ? Quels sont les corps manquants ? Ton corps est-il représenté ?
- Élargis tes sources (réseaux sociaux, films, télévision, etc.) pour inclure les corps qui représentent également des personnes grosses, noires, homosexuelles, handicapées et autres. Pose-toi les questions suivantes : comment ces personnes sont-elles représentées ? Si tu étais à leur place, aimerais-tu que ton propre corps soit représenté de la sorte ? Leurs voix sont-elles incluses en plus de leurs corps ?
- Prête attention à ce que tu dis : fais-tu des commentaires sur ton apparence (grosse, mince, laide, agréable etc.) ? Fais-tu des commentaires sur le corps des autres ?
- Essaye de complimenter les gens sur autre chose que leur corps : leurs capacités ou leurs traits de caractère, par exemple.
- Fais attention à ce que tu entends : entends-tu des commentaires ou des plaisanteries sur le corps des gens ou sur celui des autres ?
- Exprime-toi pour faire remarquer que ces commentaires peuvent avoir un effet négatif sur toi ou sur d’autres personnes.
Nous portons souvent un jugement sur le corps des autres et sur le nôtre : nous le commentons et déterminons s’il est valable ou non sur la base de stéréotypes. Cela s’applique également au bon jugement et aux compliments, puisqu’ils ont aussi leur revers de médaille. Par exemple, si nous disons à quelqu’un-e : “As-tu perdu du poids ? Tu as l’air en forme”, nous sous-entendons que “je t’apprécie davantage maintenant que tu es plus mince. Je ne te trouvais pas aussi désirable ou belle/beau lorsque tu étais plus gros-se”. Reconnaître ce qui influence nos idéaux de beauté est la première étape pour les remettre en question.
Examinons maintenant quelques cas spécifiques.
Tabous autour du corps et de la sexualité
Notre image corporelle a une grande influence sur notre sexualité et il y a certaines parties de notre corps dont nous avons tendance à ne pas parler ou que nous n’explorons même pas nous-mêmes. Cela s’explique également par les nombreux tabous qui entourent le corps et la sexualité.
Par exemple :
Les organes génitaux
Dans la pornographie, nous avons tendance à voir des images très homogènes de vulves et de pénis, mais ce n’est pas toute la réalité ! Pour de nombreuses personnes, des sentiments négatifs à l’égard de leurs organes génitaux les ont empêchées de vivre leur sexualité librement et positivement. De nombreuses personnes ayant une vulve ont recours à la chirurgie esthétique pour réduire la dimension de leurs lèvres intérieures. Les vulves, en particulier, peuvent prendre de nombreuses formes différentes, mais elles sont rarement représentées. Un projet qui vise à montrer la variété des vulves est The Vulva Gallery, qui partage des dessins et des histoires sur la grande variété de vulves qu’il y a dans le monde !
Chaque vulve est unique !
Regardez cette vidéo de Planned Parenthood
La pilosité corporelle
La pilosité corporelle, en particulier sur certaines parties du corps des femmes, est considérée comme taboue dans de nombreux environnements sociaux. Elle est considérée comme sale et peu attrayante. Ce tabou remonte aux civilisations antiques romaines et égyptiennes, qui considéraient les corps dépourvus de poils comme des symboles d’un statut social élevé ou de beauté. Pourtant, les poils ont une raison d’être : ils te protègent de la saleté et régulent la température de ton corps. Récemment, de plus en plus de personnes ont commencé à garder et à montrer leurs poils, ce qui, espérons-le, contribuera de plus en plus à réduire le tabou et les réactions négatives qui l’entourent, afin que les gens puissent choisir librement de s’épiler ou non.
- Les menstruations
Le tabou entourant les menstruations remonte également à la Rome antique. Depuis, les menstruations sont perçues comme impures ou gênantes, comme quelque chose qui doit être caché. Aujourd’hui encore, dans de nombreuses régions du monde, des femmes sont exilées ou isolées parce qu’elles sont considérées comme impures lorsqu’elles ont leurs règles. En général, une grande partie des personnes ayant une vulve se sentent honteuses pendant leurs règles.
Ici aussi, de nombreux mouvements sociaux féministes se sont battus pour surmonter ce tabou et normaliser la menstruation
Mythe : Le sang menstruel est impur ou sale
Fait
Le sang menstruel est une fonction naturelle de l’organisme et n’est pas impur. Il se compose de sang, de tissus et de fluides, et a pour but d’éliminer la muqueuse utérine (voir module 4).
Mythe : Les personnes qui ont leurs règles sont émotionnellement instables
Fait
Les changements hormonaux pendant les règles peuvent affecter l’humeur, mais les émotions varient d’une personne à l’autre. Les menstruations n’invalident pas la stabilité émotionnelle d’une personne.
Mythe : Les douleurs menstruelles ne sont qu'une gêne mineure
Fait
Les douleurs menstruelles peuvent être graves et débilitantes pour certaines. Il est essentiel de reconnaître et de traiter sérieusement les douleurs menstruelles sans les rejeter parce qu’elles sont liées à des préjugés sexistes.
Il en existe bien d’autres qui varient d’un pays à l’autre. Vous connaissez sans doute les superstitions qui interdisent de toucher les plantes pendant les règles, de ne pas faire de pain parce qu’il ne lève pas, de ne pas prendre de bain, etc. Bien qu’il ne s’agisse pas seulement de mauvais mythes (beaucoup d’entre eux sont liés à des symboles de fertilité qui sont célébrés avec joie dans de nombreux pays), il n’y a aucune preuve de ces choses et il est important de les déconstruire afin de normaliser une chose aussi commune que les règles.
Regardez cette vidéo sur les menstruations !
La contraception :
Comme vous l’avez vu dans le module 4, il existe deux méthodes différentes pour prescrire la pilule contraceptive pour les personnes ayant une vulve : le traitement le plus connu avec une pause de 7 jours (appelée “pause d’hémorragie de privation”) et le plus récent et le plus précis scientifiquement, sans pause. Il est intéressant de savoir que la première méthode est davantage ancrée dans les croyances et les traditions culturelles que l’autre et c’est pour les raisons suivantes qu’elle est la plus adoptée et la plus utilisée : .
- Elle imite les cycles menstruels naturels :
La pause traditionnelle correspond à la croyance historique selon laquelle imiter un cycle menstruel mensuel est une approche plus “naturelle” ou familière. - Les règles régulières, un élément culturel important :
Certaines cultures accordent de l’importance à la régularité des menstruations en tant que marqueur de santé et de fertilité. - Tradition et familiarité :
Les pratiques historiques et les croyances culturelles traditionnelles ont influencé l’acceptation et la préférence pour la semaine de pause. - Rythmes cycliques :
S’alignent sur les perceptions culturelles des rythmes cycliques, qui symbolisent la régularité et l’ordre. - Symbolisme de la fertilité :
La menstruation régulière est historiquement liée à la fertilité, et le fait de saigner pendant l’hémoragie de privation peut symboliser la capacité de reproduction d’une femme.
Bien qu’il puisse y avoir des divergences entre une approche traditionnelle et une approche scientifique, il est important de garder à l’esprit que chaque contexte culturel est pertinent et doit être pris en compte lors du choix d’une méthode ou d’une autre.
Corps gras et non conformes
La grossophobie est la discrimination, l’aversion et la stigmatisation des personnes grosses en raison de leur poids. Comme beaucoup d’autres formes de discrimination, elle est ancrée dans les stéréotypes et les préjugés. Voici quelques exemples de manifestations de la grossophobie :
- Juger le corps des gens
- Complimenter la perte de poids
- Expliquer les avantages de la perte de poids de manière généralisée et condescendante
- Donner des conseils sur la perte de poids
- La surveillance alimentaire
- Représenter des corps gros comme indésirables ou malades
- Considérer les personnes grosses comme peu attirantes
- Les discriminations au travail fondées sur le préjugé selon lequel les personnes grosses sont paresseuses
- Les brimades et le dénigrement manifeste des personnes grosses
- L’incapacité de l’industrie de la mode à s’adapter à toutes les tailles de corps
- Les erreurs de diagnostic et les mauvais traitements dans le système de soins de santé en raison du préjugé selon lequel les personnes grosses manquent de discipline.
Cette liste nous apprend que la grossophobie affecte la vie personnelle, la vie professionnelle, l’éducation, le bien-être social, la santé mentale, la santé physique, ainsi que les relations sexuelles et amoureuses. Pour lutter contre la grossophobie, tu peux commencer par suivre les conseils ci-dessus !
Corps racisés
Comme nous l’avons dit, la race n’existe pas au sens biologique et naturel du terme. En revanche, elle existe socialement en tant que régime de pouvoir. Parler de race, c’est qualifier la manière dont les hiérarchies continuent d’être produites, et préciser qu’elles le sont sur la base de l’origine réelle ou supposée d’un-e individu-e : on parle ainsi de catégories raciales (personnes perçues comme noires, arabes, asiatiques, etc.). Le recours à cette notion est d’autant plus nécessaire dans l’Europe actuelle qui nie l’existence du racisme “en étant aveugle à la couleur”.
Les personnes racisées sont celles qui sont touchées par les processus de stigmatisation et d’exclusion du racisme. Ce processus est le processus de racialisation, et vise à hiérarchiser les individu-e-s sur la base de leur race supposée, en les classant en groupes blancs et non-blancs, dominants et minoritaires.
Les personnes et les corps racisés font l’objet de nombreuses discriminations liées à la sexualité.
Ces stéréotypes et discriminations sont également enracinés dans l’héritage de la colonisation, qui a favorisé une vision euro- et occidentalo-centrée du monde qui se répercute encore aujourd’hui dans la représentation des corps racialisés. La colonisation a contribué à construire une image de l’Autre (les peuples colonisés) comme sauvage, vulgaire et plus proche de la nature, nécessaire pour justifier l’exploitation de la terre, du travail et des corps par le colonisateur européen rationnel et “civilisé”.
Il est important ici aussi de reconnaître les causes profondes des stéréotypes afin de continuer à décoloniser nos croyances et nos visions du monde, qui sont encore influencées par les visions coloniales du monde. Voyons quelques exemples liés à la sexualité :
De nombreuses femmes racisées sont sujettes au fétichisme racial :
« Les femmes noires sont perçues comme agressives, pas douces, toujours en quête de sexe (France , 37 ans) ».
« Parce que ma mère est chinoise, on me demande si elle fait des massages (France ,17 ans) ».
« Je suis d’origine algérienne et les personnes (non algériennes/arabes/musulmanes) ont toujours été curieuses de savoir si j’allais mettre le hijab ou non (France, 16 ans) ».
« Ils me considèrent, moi la femme noire, comme une resquilleuse, si je suis avec un mec, ils pensent que c’est à cause de l’argent (France, 18 ans) ».
Le fétichisme est l’une des discriminations à l’intersection du racisme et du sexisme dont souffrent les femmes racisées. Il s’agit d’une forme d’expression raciste visant à porter un intérêt affectueux, intime et/ou sexuel aux personnes non-blanches. En particulier, à travers la pluralité des stéréotypes de genre et de race véhiculés depuis l’époque coloniale. Par exemple, l’imaginaire animalier est associé à certaines femmes noires en tant que “tigresses” ou “lionnes”, ou à des femmes asiatiques très obéissantes et agréables aux hommes. Le fétichisme racial est très souvent un processus intériorisé par certain-e-s individu-e-s des groupes majoritaires – mais pas seulement – et représente un réel danger pour celleux qui le subissent.
Vidéo – Fethishization of racialized women (en anglais)
Les hommes racisés sont souvent associés à des idées stéréotypées de la masculinité :
« Les gens pensent qu’étant donné que je suis un homme d’Asie de l’Est, je suis féminin et que je ne suis pas bon pour le sexe. (France , 45 ans) »
« D’autres camarades de classe me posent des questions sur la taille de mon pénis. ( France, 18 ans) »
« Les gens pensent que parce que je suis “arabe”, je ne traiterai pas bien les femmes ou que je suis violent, mais ce n’est pas le cas. (France, 17 ans) »
Nous avons parlé de la masculinité dans le module 2, en soulignant qu’il s’agit d’une construction sociale et qu’elle peut donc varier en fonction du contexte social. En Corée du Sud, par exemple, il n’est pas surprenant qu’un homme hétérosexuel cisgenre se maquille et s’épile, ce qui, en Europe, est associé à la féminité.
L’idéologie coloniale a véhiculé deux types de portraits d’hommes racisés : soit hypersexualisés, soit efféminés. Voici quelques stéréotypes courants :
- Les hommes noirs sont souvent stéréotypés comme ayant des attributs sexuels surdéveloppés et comme étant sexuellement performants.
- Les hommes perçus comme arabes sont tellement stigmatisés que leur image masculine représente un danger, une violence machiste. Raewyn Connell qualifie cette masculinité de “marginalisée” : elle possède tous les attributs de la masculinité hégémonique[1], mais est rendue dangereuse par un élément extérieur au genre : la race et/ou la classe.
- Les hommes asiatiques sont souvent stéréotypés comme étant féminins et donc désexualisés.
Le rôle de contrôleurs de la sexualité que les colonisateurs blancs se sont octroyés n’a pas beaucoup changé depuis. Aujourd’hui encore, certains hommes sont considérés comme trop virils, d’autres pas assez… mais par rapport à qui ? Il faut se demander sur quels critères se fondent ces jugements, et qui en est le centre.
Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit également d’une question de représentation. Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’acteurs issus de milieux populaires et/ou racisés, ce qui n’était pas le cas jusqu’au 20e siècle. Par exemple, les acteurs asiatiques qui étaient très connus dans leur pays d’origine et qui jouaient principalement le rôle du héros ou du grand romantique devaient se transformer en méchants hostiles lorsqu’ils arrivaient à Hollywood. Les films dans lesquels ils jouaient se terminaient toujours par la victoire du héros blanc sur le méchant racisé, le sauvetage et la conquête de la belle (souvent blanche). Les acteurs racisés étaient presque systématiquement cantonnés à des rôles de méchants, d’auteurs d’agressions sexuelles ou de marginaux (la construction de leur personnage s’arrêtait à ces caractéristiques ; leur famille, leurs loisirs et leur personnalité n’étaient pas développés). Il est important d’être vigilant-e pour cesser d’alimenter ce mythe raciste, xénophobe parfois islamophobe d’une image biaisée des hommes racisés et/ou en situation de migration.
[1] La masculinité hégémonique est un concept qui renvoie pour la sociologue australienne Raewyn Connell au “type de masculinité qui, à un moment donné, domine les représentations de la masculinité. […] La masculinité hégémonique est donc l’expression même du pouvoir des hommes sur les femmes et sur d’autres hommes, considéré(e)s comme inférieur(e)s du point de vue de leurs attributs de genre. Elle est généralement adossée à d’autres formes de pouvoir (pouvoir économique, culturel, symbolique, etc.).”
Pornographie
Internet offre de nombreuses informations et images relatives à l’activité sexuelle et constitue pour les jeunes une première exposition à la sexualité ou à l’éducation sexuelle. Internet et les médias sociaux offrent un potentiel considérable pour améliorer l’accès à des informations constructives, exactes et non moralisatrices sur la sexualité et les relations. Néanmoins, ces technologies ont également la capacité de vous exposer à des informations inexactes et inappropriées, renforçant potentiellement des normes de genre néfastes en facilitant l’accès à une pornographie souvent violente.
Quel est le rôle de la pornographie dans la perpétuation des images corporelles, des tabous et des stéréotypes de genre ?
La pornographie : Quel est le rôle de la pornographie dans la perpétuation des images corporelles, des tabous et du genre ?
La pornographie est souvent la principale source d’information sur la sexualité pour les jeunes, mais il est important d’être conscient-e de ce que l’on voit pour éviter de se faire de fausses idées sur le sexe.
Ce qui se passe dans le porno n’est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Pourquoi ?
- Les personnes qui y figurent sont des acteur-rice-s et jouent comme dans un film
- Les scènes pornographiques montrent rarement une communication et un consentement explicite entre les personnes impliquées.
- Les acteur-rice-s utilisent rarement des moyens de protection ou de contraception.
- Les corps montrés dans le porno sont souvent très conformistes. Comme dans d’autres types de médias, le porno ne représente pas non plus la variété des corps qui existent dans le monde réel.
En ce sens, la pornographie peut être l’une des sources d’information les plus inexactes, en particulier lorsqu’aucune éducation sexuelle n’est dispensée. N’oublie donc pas que la pornographie est un divertissement et non une source d’information ou d’éducation !
Regardez cette vidéo sur Porn Literacy
Religion et sexualité
La religion influence profondément le domaine de la sexualité, avec des normes morales qui définissent ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas pour les adeptes d’une religion particulière. Ces normes peuvent varier considérablement d’une religion à l’autre. Certaines considèrent que l’activité sexuelle ne vise qu’à la reproduction, d’autres la célèbrent comme une expression du divin.
Voyons quelques-uns des thèmes abordés par les religions en matière de comportement sexuel (la sélection a été faite sur la base des citations recueillies auprès des jeunes et des adultes que nous avons rencontrés) :
The concept of marriage and interreligious marriage
« Le mariage est la moitié de ma religion. (France , 17 ans) »
« Je veux me marier avec quelqu’un de ma religion pour ne pas avoir à y renoncer. (France, 16 ans) »
« Dans ma religion, il faut se marier. (France, 17 ans) »
Le mariage est l’union légalement ou formellement reconnue de deux personnes en tant que partenaires dans une relation personnelle (selon Oxford Languages). Il est profondément ancré dans de nombreuses cultures, bien qu’il s’agisse d’un choix que tout le monde ne souhaite pas ou n’a pas besoin de faire.
Les raisons pour lesquelles les gens se marient sont nombreuses, notamment le concubinage, l’engagement à long terme, les raisons juridiques (par exemple, prendre soin de partenaires malades), les raisons financières (par exemple, les impôts sont plus avantageux). Ces raisons comprennent également les normes sociales et religieuses. Pendant des siècles, la religion a été la principale raison pour laquelle les gens se mariaient. Les différentes religions et cultures ont des cérémonies et des connotations différentes de ce que cela signifie.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes optent pour un mariage civil plutôt que pour un mariage religieux. Mais quelles sont les différences ?
Un mariage religieux est un mariage célébré dans une église, une chapelle ou tout autre bâtiment autorisé, conformément aux rites et aux cérémonies d’une confession religieuse. Pour chaque confession religieuse, il existe des différences dans le rite, ainsi que dans la signification. Le mariage civil, quant à lui, est un mariage célébré en tant que contrat civil, sans affiliation religieuse. Selon la loi du pays où l’on se marie, il y aura une cérémonie civile, une cérémonie religieuse, ou les deux (pour les personnes choisissant un mariage religieux).
Lorsque deux personnes issues de religions différentes se marient, on parle de mariage interconfessionnel. Si les époux souhaitent se marier lors d’une cérémonie religieuse, il peut être possible, en fonction de leur religion, de le faire sans renoncer à leur culture et à leurs croyances. Cela dépend généralement de la religion ou du courant spécifique. Par exemple, le christianisme l’autorise normalement, mais avec des permissions spéciales et la condition d’élever les enfants dans la foi chrétienne ; dans l’islam, il existe différentes interprétations, mais cela peut aussi dépendre de la religion de l’autre personne ; dans le judaïsme, cela dépend du courant spécifique.
Alors que le mariage a longtemps été réservé aux couples hétérosexuels, de plus en plus de pays ont récemment légalisé le mariage homosexuel, qui n’était pas légal depuis longtemps. À l’heure actuelle, 35 pays légalisent le mariage homosexuel : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, Andorre, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Danemark, l’Équateur, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse, Taïwan et l’Uruguay.
Regardez cette vidéo de la série “Cuties” de Netflix !
Le concept de virginité
« Pour moi, il est très important que la femme que j’épouse n’ait pas été touchée (sexuellement) par un autre homme auparavant, car c’est ce que dicte ma religion. (France, 16 ans) »
« Une fois, enfin plusieurs fois, un camarade de classe m’a demandé si j’avais déjà perdu ma virginité et quand je serai prête. Je pense que le fait de me demander autant de fois signifie qu’il veut que je lui dise que je veux le faire avec lui. J’ai simplement dit “non” parce que si je ne suis pas prête, je ne vais pas répondre oui et encore moins si je me sens sous pression. Je suis fière de moi pour cela ».
La virginité est l’état d’une personne qui n’a jamais eu de relations sexuelles. Mais ce sont les différentes interprétations qui ont été faites autour de ce concept qui sont vraiment intéressantes à comprendre. Les interprétations dépendent des cultures, des religions, des croyances individuelles, mais aussi de l’époque. Nombreux-ses sont celleux qui pensent que c’est en ayant un rapport sexuel avec pénétration pour la première fois que l’on perd sa virginité. Mais combien de personnes et de pratiques sont exclues de ce discours ? Les premières fois peuvent impliquer du sexe oral ou anal par exemple, ou de nombreuses expériences qui n’impliquent pas de pénétration. Tu peux consulter le Jouissance Club pour en savoir plus sur les relations sexuelles sans pénétration : https://www.instagram.com/jouissance.club/ .
La religion est historiquement l’un des facteurs les plus importants dans la construction sociale du concept de virginité tel qu’il est compris aujourd’hui. En effet, que ce soit dans le christianisme, l’islam, le judaïsme ou même l’hindouisme, les croyant-e-s sont censé-e-s avoir des relations sexuelles après le mariage et pas avant. Bien que la religion puisse être pratiquée différemment d’un-e individu-e à l’autre, cette “règle” de chasteté avant le mariage encourage les gens à considérer la virginité comme un symbole de pureté et de moralité, en particulier lorsqu’il s’agit des femmes. Un exemple classique est celui de la Vierge Marie dans la religion chrétienne : elle est admirée par les croyant-e-s parce qu’elle a eu un enfant sans jamais avoir recours à des actes sexuels.
Le test de virginité consiste à vérifier si une personne est vierge ou non, généralement en mesurant l’hymen ou la laxité vaginale. En réalité, la virginité est une construction sociale, et il n’existe donc pas de véritable “test de virginité”. Pourtant, ces pratiques remontent à loin et sont toujours d’actualité dans de nombreuses régions du monde. Dans les années 1800, en France, la virginité féminine était célébrée par des événements culturels tels que l’élection des “rosières” : de jeunes villageoises choisies pour leur “vertu”. Ces jeunes femmes devaient présenter un certificat de virginité. Un médecin procédait à un examen physique, par exemple en introduisant deux doigts dans le vagin de la femme, pour mesurer l’hymen ou la laxité vaginale. Partout dans le monde, des femmes dont la virginité n’a pas été reconnue avant le mariage ont été rejetées par leur famille et leur communauté, ont été violées et, dans certains cas, ont même été tuées. Ces situations existent encore aujourd’hui, même si l’OMS et l’ONU condamnent la pratique des tests de virginité.
Il s’agit là de deux faits importants concernant les tests de virginité qu’il est important de prendre en considération :
- Penser que l’on peut vérifier la virginité de personnes ayant une vulve, c’est affirmer que les relations sexuelles se résument à la pénétration. Cela repose sur une vision hétérocentrique et pénétrocentrique de la sexualité que nous devrions abandonner pour considérer tous les types de rapports sexuels comme également valables.
- De nombreuses idées préconçues sur le fonctionnement de l’appareil génital féminin et sur ce qui s’y passe pendant les rapports sexuels doivent être déconstruites. En particulier :
- L’hymen n’est pas mesurable. Certaines personnes ayant une vulve naissent d’abord sans hymen, ou celui-ci peut disparaître complètement à la maturité sexuelle, ou encore son étirement peut varier avec le temps et la pratique d’activités autres que la pénétration vaginale. S’il est présent, il ne se déchire pas nécessairement, il peut simplement s’étirer ou même rester intact. Toutes les personnes ayant une vulve ne saignent pas lors de la première pénétration, et les saignements pendant les rapports sexuels peuvent également résulter d’un manque de lubrification ou d’un frottement trop brutal de la paroi vaginale.
- La laxité vaginale est une diminution de la fermeté des muscles entourant le vagin. Elle est généralement causée par la génétique, l’âge, les variations hormonales, l’accouchement et d’autres facteurs de santé. La laxité vaginale n’apparaît pas chez tout le monde après un rapport sexuel. En général, après la pénétration ou l’utilisation de certains sextoys, le vagin retrouve son étanchéité naturelle.
Historiquement, il existe une double norme culturelle entre les hommes et les femmes en matière de sexualité, et le discours sur la virginité est un exemple clair des normes sociales qui sont généralement beaucoup plus laxistes pour les hommes que pour les femmes. Les jeunes hommes sont souvent encouragés à avoir des relations sexuelles, presque comme un rite de passage à l’âge adulte. La virginité des femmes est plutôt liée à des mécanismes patriarcaux oppressifs, tels que la garantie que les enfants “appartiennent” biologiquement à leur père.
Le fait d’être ou de ne pas être vierge n’est pas un indicateur de promiscuité ou de maturité sexuelle. Choisir d’avoir des relations sexuelles “pour la première fois”, quoique cela puisse signifier, est une décision personnelle : elle peut être liée à des croyances religieuses et spirituelles, à des valeurs familiales et personnelles, au désir ou à l’absence de désir, à ton cheminement personnel dans la découverte de ton identité sexuelle. Essaye de toujours te demander : suis-je heureux-euse des expériences sexuelles que j’ai eues ou que j’ai décidé de ne pas avoir ? [1]
[1] https://www.plannedparenthood.org/learn/teens/sex/virginity
Reférénces
A simple guide to great sex-ed: how to talk about body image. Split Banana. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://splitbanana.co.uk/blog/2020/11/12/sex-education-guide-body-image
Care International (2021). The Period Taboo: A Universal Problem. Care International. Last retrieved 30 January 2024 from https://www.care-international.org/stories/period-taboo-universal-problem
Gainor, K. (2023). Body image and adolescent sexual health. Administration on Children, Youth and Families, Family and Youth Services Bureau. (n.d) Last retrieved 30 January 2024 from https://teenpregnancy.acf.hhs.gov/sites/default/files/resource-files/body-Image-and-adolescent-sexual-health.pdf
Ianiro M.C. Il Body Positivity in un’epoca di cambiamento. Canadausa. Unibo. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://site.unibo.it/canadausa/it/articoli/body-positivity-in-un-epoca-di-cambiamento
Ly G., Diallo R. (speaker). La geisha, la panthère et la gazelle . Kiff ta race [podcast] (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/la-geisha-la-panthere-et-la-gazelle
Ly G., Diallo R.(speaker). Féminismes pour toutes . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/feminismes-pour-toutes
Ly G., Diallo R. (speaker). De quoi le voile est-il le nom? . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/de-quoi-le-voile-est-il-le-nom
Ly G., Diallo R. (speaker). Les couleurs des sentiments . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/les-couleurs-des-sentiments
Lowe M. (2021). What is fatphobia?. All about obesity. Last retrieved 30 January 2024 from https://allaboutobesity.org/your-guide-to-understanding-and-combating-fatphobia/
Porn. Plannedparenthood. (n.d) Last retrieved 30 January 2024 from https://www.plannedparenthood.org/learn/teens/sex/porn
Zasadny K. (2022). Why Is Body Hair Still Taboo For Women? Why Was It Ever?. Medium. Last retrieved 30 January 2024 from https://medium.com/think-dirty/why-is-body-hair-still-taboo-for-women-why-was-it-ever-4c89534461e3
36 superstitions about periods from around the world (2017). Clue. Retrieved 5 September 2017 from https://helloclue.com/articles/culture/36-superstitions-about-periods-from-around-world
Srikanthan A., Reid L. R., (2008). Religious and cultural influences on
contraception. Jogc. Retrieved February 2008 from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)32736-0/pdf





